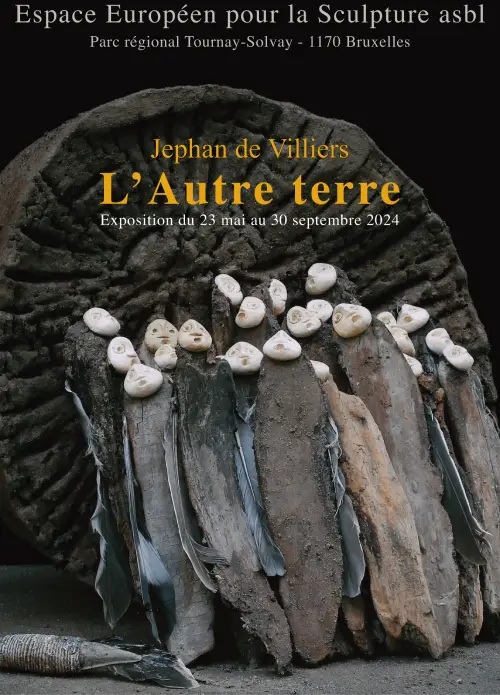CLEMENCE VAN LUNEN
Au printemps 1997, Clémence van Lunen a été la représentante des Pays-Bas dans le Parc Tournay-Solvay.
Clémence van Lunen par Jean-Pierre Van Tieghem
« Une branche raconte elle-même son histoire ».
Cette phrase dite par Clémence van Lunen il y a peu de temps articule et signifie, donne le sens d’un ailleurs, d’une intimité et d’une fragilité, du “dasein” sans filet, de l’être dans le monde avant l’histoire de l’artiste et ensuite pendant. Où est alors la différence entre le corps et la sculpture, entre le fait et le reçu ? S’agit-il d’articulations et de destins avec ou sans mouvements ?
Le squelette apparait, entre la vie et l’absence, entre ce chien et loup qui ne pense plus aux couleurs, aux aux ombres anthropomorphes. Des mémoires surgissent, un jeu se joue, un jeu qui inquiète dans le corps même du bois, dans son for intérieur déshabillé par nécessité.L’os – celui du bois – dialogue avec son cartilage, sa fragilité et sa courroie de transmission, ce dialogue proposé tel quel, presque à l’insu. Mais en complicité. Et pourtant sans répit, car le bois tient à son bois. Il s’érectile et prend, se couche et se donne, se distrait dans ses élongations sensuelles sur un gazon, caresse les végétables évidents, évacue le superflu.
Le spectateur n’oublie pas que la veille il était chez le cordonnier qui a ressemelé ses souliers avec quelques clous et des pièces de cuir sur ses semelles. Et il regarde ce qu’il n’a jamais vu : un fil, un clou dans les sculptures de Clémence van Lunen, alors qu’il n’y a rien de cela.
Apparaît une adhésion de bois à bois, de nature à culture et vice-versa, de “carrefour” comme disait Bachelard. Et il s’agit aussi d’un trajet qui va dans un sens. Quel sens ? Et le bois parle, dans ses nœuds et dans ses trous, dans ses intimités, dans ses absences et dans ses désirs d’adhésion.
Tout est prêt. La rupture est. Rien ne tenir joint le haut et le bas du corps. La forêt est chaude et la nuit des hommes affreuse. Tout ici est à l’abandon. Qui s’assied sur le bois a le bois qui parle pour lui et parle haut, ne cède en rien parce qu’il ne s’est pas lavé la veille. La forêt grouille. On est mal à l’aise. “L’arbre ici… mène grand train” comme l’écrivait Henri Michaux dans “Ecuador”. Il faut regarder debout. Aussi le regard est oblique, là où c’est bon de découvrir la différence et l’essence. Le rêve vient après. Il a été de longue haleine. Il a fallu le porter. Et l’autobiographie est présente. Comment ? A travers les os, les eaux des fleuves et les huiles végétales, dans une sorte de mouvement dans l’espace. A la façon, pourquoi pas, d’un partage de rêves culturels et personnels venus d’ailleurs. Tout le monde danse dans des gestes qui n’arrêtent pas de se faire. Clémence bifurque en même temps que les branches. Ce sont des gestes émouvants, ses interrogations.
Elle regarde les corps, les êtres (les hêtres), les noms et les endroits, les troncs et les racines. Elle écoute les liturgies obscures. Elle image le choix des bois dans ses racines, dans ses virgules, dans ses absences.Que deviennent ces jambes, ces genoux, ces nombrils immobiles dans la chair de ces bois ? L’attente est longue, sous le signe peut-être des nymphéas, dans la discrétion. l’artiste part. Le sculpteur, elle, intrigue. La vie est renversée. On meurt à sa place : la place de l’arbre et de ses racines. La pente est rapide. Comme dans un orage qui marque, qui blesse. Il suffit de porter un regard sur soi, sur son corps. Et réfléchir.